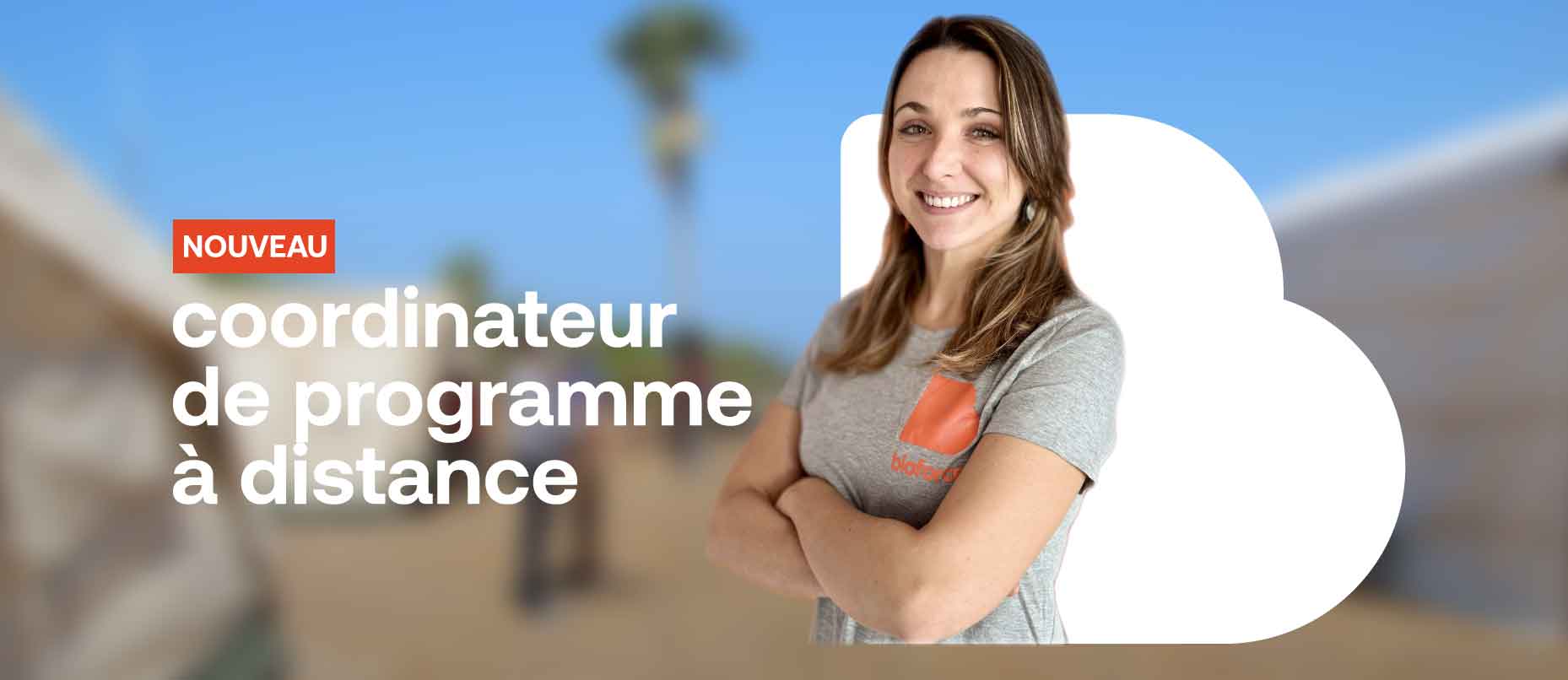Gobelins x Bioforce
Dromadro : « Dans mon pays, les humanitaires sont partout »
Gobelins X Bioforce. Pris dans la terrible guerre de 2013 en Centrafrique, Dromadro n’a qu’un objectif : mettre son grand-père en sécurité. De retour en France, son avis est fait : il deviendra humanitaire. Son témoignage pour Bioforce a été adapté en 2023 en un court-métrage en motion design par Pierre Roussel, étudiant à l’école d’animation des Gobelins.
Mon premier humanitaire, je l’ai rencontré lorsque j’avais six ans
Je m’appelle Dromadro, je vis en France depuis longtemps mais je suis né à Bangui, la capitale de la Centrafrique.
Mon premier humanitaire, je l’ai rencontré lorsque j’avais six ans, en 1996. A l’époque, un coup d’état militaire tente de renverser le Président Ange-Félix Patassé. Le putsch est raté mais les humanitaires ont afflué. Je n’avais pas à l’époque conscience de qui ils étaient ni de ce qu’était leur travail, mais c’était une présence familière dans la ville.
Une nouvelle série de troubles éclate en 2003 et le général Bozizé accède au pouvoir [ce qui va mener à une première guerre civile qui ravage le pays jusqu’en 2007, puis une deuxième en 2012]. Je suis alors un peu plus grand et j’ai désormais conscience du rôle de l’aide humanitaire dans nos vies, de ces gens qu’on voit arriver en 4×4 et qui aidaient par des distributions alimentaires dans notre quartier. Je viens d’une famille de commerçants aisés d’origine tchadienne et nous habitions le Quartier Cameroun au PK5 [le point kilométrique 5, situé à 5km du rond-point du centre-ville]. Le PK5, c’est le quartier musulman et populaire, considéré comme le poumon économique de la Centrafrique. C’est là où transitent traditionnellement tous les produits venant du Cameroun voisin qui est la voie quasi exclusive d’approvisionnement du pays.
A l’époque, les humanitaires sont partout, pour aider les plus vulnérables, faire des distributions alimentaires ou soigner les gens. Ils faisaient un peu de tout. C’est à cette époque-là, que je pense pour la première fois que le travail de ces gens est intéressant et que ça me plairait moi aussi, d’intervenir pour venir au secours des plus vulnérables. C’est aussi à cette période, adolescent, que je rencontre des amis d’amis, des compatriotes, qui ont été formés à Bioforce et qui travaillent comme humanitaires. J’apprends donc qu’une école pour devenir humanitaire existe, dans la ville de Lyon en France, avec une belle réputation pour se former à ces métiers. Je me dis que c’est vraiment quelque chose que je voudrais faire.
On ne peut pas souhaiter ça, même à son pire ennemi
Mais en mars 2013, mon pays vit de nouveaux troubles : des groupes rebelles, les Séléka, des Centrafricains de confession musulmane du nord du pays, prennent les armes pour chasser du pouvoir le président Bozizé. Leur chef, Michel Djotodia s’auto-proclame président et de très nombreuses exactions sont commises avant que des milices d’autodéfense ne se forment, les anti-balaka, chrétiens ou animistes mais surtout « anti-musulmans ». La situation est horrifique et est qualifiée de « pré-génocidaire » par la France qui envoie des troupes pour « l’Opération Sangaris ». Sous la pression internationale Djotodia démissionne dix mois après son accession au pouvoir et un accord de cessation des hostilités est signé en 2014.
Cette guerre, c’est quelque chose que je ne souhaiterai pas à mon pire ennemi. Parce que des guerres j’en ai vécu, mais cette guerre-là, au début de l’année 2013 était simplement insoutenable. La plus violente qu’on puisse imaginer. Les Seleka sont venus voler, tuer, égorger. Ce sont des terroristes, des bandits, pas des musulmans. Tout le monde a été victime de la Seleka. Quand ils se sont retirés du pouvoir, tous les musulmans qui étaient dans les huit arrondissements de Bangui et les autres communes centrafricaines se sont fait massacrer par les anti-balaka en représailles. Les musulmans ont fui les exactions et se sont réfugiés au PK5. Les humanitaires qui travaillent pour la Croix-Rouge, nous escortaient à la grande mosquée de l’arrondissement, la mosquée Ali Babolo. Sur le chemin, des femmes éventrées, des enfants égorgés. [La voix trébuche. Il s’interrompt un instant].
On ne peut pas souhaiter ça, même à son pire ennemi. Cette guerre a été la plus sanglante de l’histoire de la République centrafricaine. A cette époque, j’ai 23 ans, je réside encore à Bangui, mais je voyage déjà énormément, dans toute la sous-région mais aussi en Europe pour aider mon père commerçant. Lorsque les exactions commencent, je suis en France et mes parents, mes frères et mes cousins sont rentrés se réfugier au Tchad. Mais mon grand-père a refusé de partir. Il a vécu 50 ans en Centrafrique, il y a construit sa maison, il y a tout investi, sa vie était là. Il a refusé catégoriquement de rentrer au Tchad malgré les supplications de sa fille, ma mère. Il faut que j’aille le chercher. J’avais un lien très fort avec mon grand-père, alors ma mère m’a demandé de le convaincre : je suis donc parti pour Bangui.
Tout le monde était terrifié
J’avais des connaissances à l’aéroport de Bangui qui, lorsqu’ils m’ont vu, m’ont demandé l’air agressif ce que j’étais venu chercher ici. « Tu veux qu’on te tue ? Est-ce que tu veux mourir ? » C’est la première chose qu’ils m’ont dit. Des gens avec qui j’ai grandi, avec qui j’ai passé tant de super moments. D’autres musulmans étaient là aussi. Mais les anti-balaka encerclaient l’aéroport et chantaient : « Si vous sortez de là on vous tuera ». Tout le monde était terrifié. C’est l’armée française appelée par l’aéroport qui m’a escorté jusqu’au PK5.
Mon grand-père n’en démordait pas. Il a fallu quelques jours mais il a fini par craquer. « C’est la vie. Je vais retrouver mes enfants ». Il n’a jamais revu Bangui.
L’armée française, la Minusca [les casques bleus de l’ONU en Centrafrique] et l’armée tchadienne nous ont escortés pour sortir du pays par la route car il n’y avait pas d’avion direct. Les gens qu’on croisait voulaient nous tuer, promettaient de nous massacrer. C’est difficile à vivre, particulièrement quand ce sont des gens que tu as bien connus, qui te le disent en face. Mes parents nous attendaient de l’autre côté de la frontière, ils nous ont récupéré. Heureusement j’ai une famille qui a quelques moyens. Mais il faut imaginer le sort des autres personnes et imaginer des centaines de personnes, des gens qui n’avaient rien, qui ont tout perdu, qui n’avaient personne.
Depuis, mes parents sont rentrés à Bangui, je suis rentré en France. Mon opinion était définitivement faite : j’ai franchi les portes de Bioforce, j’ai pris tous les renseignements, je me suis inscrit aux newsletters. Mais il me fallait réunir l’argent pour m’inscrire. J’ai économisé plusieurs années, toqué à toutes les portes pour m’aider à financer ma formation. La directrice de mon dernier emploi a été compréhensive et a encouragé ma vocation. J’ai aussi pu obtenir une bourse de la région Auvergne Rhône-Alpes. Aujourd’hui, je suis à quelques semaines de la fin de ma formation. Je me sens prêt, opérationnel. Projet d’urgence ou de développement, quel que soit le contexte, je sais que je peux intervenir là où sont les besoins.
* Le prénom a été modifié.

Devenez humanitaire avec Bioforce
Les ONG ont besoin de professionnels qualifiés, capables de répondre efficacement aux crises humanitaires et d’aider les populations vulnérables. Et si c’était vous ? Que vous soyez jeune diplômé, humanitaire expérimenté, bachelier, ou salarié en transition professionnelle : trouvez à Bioforce la formation qui vous correspond.